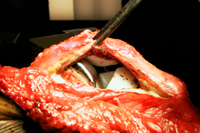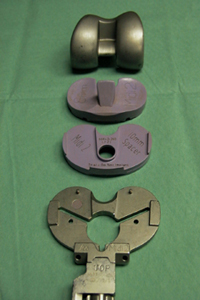|
 |
SudOrtho Docteurs TESSIER, BORRIONE, LE BAIL, LECOQ et PLOTKINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Accueil > Informations > Prothèse totale de genou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
QU’EST
CE QU’UNE PROTHESE DE GENOU ? La
prothèse totale de genou ou prothèse tri-compartimentaire existe
depuis maintenant plus de 15ans. L’articulation
du genou peut être très détruite ou voire dégradée par une usure mécanique,
c’est-à-dire de l’arthrose. Mais les causes peuvent aussi être en
rapport avec un traumatisme ou un rhumatisme inflammatoire. L’arthrose
est parfois due à l’évolution
ultime d’une atteinte ligamentaire chronique. Il s’agit alors en général
d’une arthrose rotatoire par rupture ancienne du ligament croisé antérieur
associée à une lésion méniscale. La
prothèse de genou est un ensemble mécanique qui se substitue alors à
l’articulation normale. Elle assure les mêmes mouvements de rotation
et de glissement qu’un genou normal. La
prothèse est modulaire c’est à dire qu’elle est constituée de
plusieurs pièces : -
Un condyle fémoral métallique -
Une embase tibiale métallique -
Une surface articulaire en polyéthylène (plastique) appelée
insert -
Un bouton rotulien de resurfaçage en polyéthylène -
Des quilles d’extension tibiales et fémorales permettant le
centrage des implants tibiaux et fémoraux.
Pour
sa part la rotule peut être laissée intacte si elle est correctement
centrée et si les phénomènes arthrosiques ne l’ont pas détruite.
Dans le cas contraire, le bouton rotulien est cimenté contre la face
articulaire de la rotule. Entre
les pièces fémorales et tibiales est interposée la surface
articulaire, qui est soit fixée sur le plateau métallique, soit
interposée avec un certain degré de mobilité, il s’agit alors
d’une prothèse à plateau mobile. Le
fémur vient glisser en tournant sur l’insert en polyéthylène. L’épaisseur
du polyéthylène détermine ainsi la hauteur de l’interligne
articulaire.
Dans
certains cas, il existe des pertes de substance osseuse, qui sont comblées
par des cales métalliques disponibles dans le kit de la prothèse. De même
en cas de dégradation importante de l’assise osseuse, il pourra
devenir nécessaire de recourir à des greffes osseuses. LONGEVITE
D’UNE PROTHESE DE GENOU Bien
qu’il soit difficile de prévoir avec certitude la durée de vie
d’une prothèse de genou, les dernières statistiques publiées font
état d’un « taux de survie » de 85% en moyenne à 10 ans. La
période charnière de la septième année post-opératoire semble
actuellement toujours une Les
principaux facteurs qui influencent cette durée de vie sont : -
La qualité de l’os. La surveillance de l’ostéoporose par
ostéodensitométrie est nécessaire surtout chez les femmes. -
Le type de prothèse mise en place dépendant de la pathologie de
genou sous-jacent.
- L’activité du genou opéré, et surtout la mauvaise
utilisation de la prothèse qui ne supporte pas les chocs violents ou répétés. -
La surcharge pondérale, qui majore les pics de contraintes sur
le polyéthylène. -
La « démusculation » ; une prothèse ne
fonctionne bien que si les moteurs musculaires agissant sur
l’articulation sont synchrones et adaptés. Tout
ceci revient à dire qu’une prothèse de genou se surveille régulièrement
par des examens cliniques et radiologiques ; nous en reparlerons
plus longuement ! AVANT
L’INTERVENTION Vous
devrez prendre rendez-vous avec un médecin anesthésiste un mois
environ avant la date prévue d’intervention. Cela permettra de faire
un bilan adapté à votre état de santé. Un
bilan sanguin permettra de fixer les modalités d’une technique d’épargne
de sang Cette
consultation a aussi pour but de définir le type d’anesthésie et
aussi d’analgésie post-opératoire. Un
dépistage infectieux urinaire sera effectué à titre
systématique par une cytobactériologie urinaire. Il
faudra aussi faire un bilan bucco-dentaire par une
consultation chez votre dentiste habituel afin de dépister tout foyer
infectieux latent. Consultez
votre médecin traitant si vous vous apercevez d’une infection
broncho-pulmonaire ou de tout autre problème pouvant interférer
avec votre intervention. Votre
entrée à la clinique a lieu la veille de l’intervention afin de
faire quelques examens complémentaires. N’oubliez
pas vos documents radiographiques, I.R.M., scanner et surtout télémétrie
des membres inférieurs en charge. Enfin,
une douche à la Bétadine est obligatoire avant
l’intervention dans un but d’asepsie. N’oubliez
pas de rester à jeûn à partir de minuit la veille de l’opération. VOTRE
INTERVENTION Elle
se déroule dans une salle dévolue à la chirurgie orthopédique, salle
blanche en surpression et flux laminaire. Vous
serez pris en charge par une équipe spécialisée dès votre entrée
dans le bloc opératoire.
Après
avoir branché les capteurs de contrôle des fonctions vitales Vous
serez alors installé sur le dos pendant environ 2 heures. Entre
le moment de votre arrivée au bloc opératoire et le début de l’acte
chirurgical il se passe au moins trois quart d’heure ! Une
prothèse de genou, entraîne un saignement non négligeable, et malgré
la possibilité de récupération de sang en per-opératoire, une
transfusion n’est pas à exclure. Toutes
les solutions permettant de remédier aux déperditions sanguines auront
été définies au cours de la consultation anesthésique. Aspect per-opératoire des coupes osseuses mettant tout le spongieux à nu. Toutes ces tranches osseuses peuvent saigner en per ou post-opératoire. Le
choix de la taille et du type de prothèse est fait pendant l’opération. Les
prothèses modernes sont en effet modulaires et sont à la disposition
du chirurgien plusieurs tailles fémorales, tibiales et rotuliennes. Toutes
les combinaisons sont possibles, de même que l’on peut ne cimenter
qu’un des composants sans que cela ne nuise à la résistance de la
prothèse ou à sa longévité.
Après
l’intervention, un passage en salle de réveil est obligatoire. Votre
surveillance sera alors assurée par une équipe distincte de celle du
bloc opératoire qui n’assure que le « réveil » et
la surveillance post anesthésique des patients. Les
compétences de ce personnel sont spécialement adaptées à l’étape
post-chirurgicale immédiate et toutes les décisions sont prises en
collaboration et sous le contrôle de votre médecin anesthésiste. APRES
LA SORTIE DE SALLE DE REVEIL Lorsque
le médecin anesthésiste juge que vous pouvez regagner votre chambre,
vous remontez en service d’hospitalisation chirurgicale. Votre
membre inférieur est immobilisé dans une attelle de
genou qui pourra être articulée, ou simplement maintenant le
genou immobilisé en extension. Selon
le cas une « pompe à morphine », ou un autre procédé
analgésique aura pu être installé pour atténuer les douleurs de la période
post-opératoire. La
marche doit se faire obligatoirement avec un cadre de déambulation,
puis rapidement à l’aide de cannes anglaises. LA
RECUPERATION FONCTIONNELLE La
récupération fonctionnelle est progressive avec une prothèse de
genou. Il faut faire une rééducation consciencieuse avec des progrès
réguliers dans le temps sans chercher à « brûler les étapes ». L’objectif
est de fléchir le genou à 90° vers le 15ème jour. La marche avec une
canne est autorisée en règle entre 15 jours et 3 semaines. L’autonomie
doit être récupérée à 100% en 2 mois, mais la réhabilitation complète
est obtenue en 6 mois. Il
faut tenter de dépasser les 125° de flexion du genou en fin de rééducation
. Toutefois
la prothèse de genou n’est pas aussi performante qu’un genou sain
et la restitution « ad integrum » reste exceptionnelle. Quelques
douleurs résiduelles modérées de type météorologique peuvent
persister ; elles s’estompent en général avec le temps. Tant
que le genou travaille et progresse, il n’est pas rare de devoir
traiter des phénomènes inflammatoires locaux par cryothérapie (procédés
utilisant le froid), diminution du rythme de la kinésithérapie ,voire
traitement médicamenteux.
LE PASSAGE EN SERVICE DE REEDUCATION La
rééducation d’une prothèse de genou dure plusieurs mois et doit être
poursuivie avec assiduité. En
fonction de vos progrès et des soins post-opératoires, vous serez
dirigés vers un service de rééducation. Un médecin rééducateur vous prendra en charge, il effectuera la liaison avec le kinésithérapeute et orientera celui-ci. La
poursuite de la thérapeutique inclura, ateliers au gymnase avec tapis
roulant de marche, vélo, steppers, et escaliers de rééducation. Après
une période d’hospitalisation nécessaire, la sortie pourra être
envisagée. Le
retour à domicile n’est envisagé que lorsque la déambulation est
correcte, la montée et la descente des escaliers possibles. Il faudra
aussi avoir un lieu de vie adapté à une phase de réhabilitation
physique. Par
exemple : vivre dans un troisième étage sans ascenseur rend
difficile la sortie du domicile et empêche de se rendre dans un cabinet
de kinésithérapie. En
effet, la kinésithérapie doit être poursuivie après le retour à
domicile ! Il
ne faut pas hésiter à prévoir un centre de rééducation après
l’hospitalisation en service de chirurgie. EN
CAS DE PROBLEMES.... La
prothèse de genou implantée demande de votre part attention et
surveillance. Elle
réalise un élément mécanique qui réagit avec le tissu vivant de
votre organisme. En
chirurgie le « risque zéro » n’existe pas. Malgré la
multitude de précautions prises, un certain nombre de complications
peuvent survenir. Nous allons décrire les plus fréquentes, toutefois, il existe des complications exceptionnelles, qui surviennent parfois en cascade, et sont souvent le fait d’état général difficile ou « à risque ». Insistons encore une fois sur la nécessité d’une consultation d’anesthésie au cours de laquelle vous aurez décrit tous les problèmes de santé notables antérieurs. LA
LUXATION Exceptionnelle,
Il s’agit d’une perte de contact des 2 surfaces de glissement de la
prothèse. La
rotule peut aussi et c’est ce qui est le plus fréquent, se luxer en
externe. En
règle générale, ces luxations sont dues à un déséquilibre
musculaire, ou une chute et elles peuvent imposer la révision
chirurgicale de l’articulation et parfois la modification de l’un de
ces composants. L’INFECTION Sa
fréquence est de l’ordre de 2%, selon des statistiques locales et
nationales. En
dehors des nombreuses précautions prises par l’équipe médicale et
para-médicale, au cours de l’hospitalisation il faut encore insister
sur la prophylaxie anti-bactérienne ! Votre
peau est normalement couverte de staphylocoques, germe naturel dit
saprophyte de la peau. Dans
certains cas ce staphylocoque peut devenir pathogène et muter pour
devenir résistant. Il
est devenu le germe le plus fréquemment en cause dans les infections
peri-prothétiques. Le
taux de 2% d’ infection est actuellement devenu incompressible. Dans
tous les cas :
- Le soin de tout état infectieux intercurrent est
obligatoire. -
Ne jamais faire d’injection intra-musculaire ou sous-cutanée
du côté de la prothèse. -
Surveillance régulière de l’état dentaire et pulmonaire
surtout si une infection à déjà été dépistée. -
Chez les femmes, surveillance des infections urinaires et
chez les hommes, dépistage des problèmes prostatiques. -
Désinfecter toute plaie cutanée, le staphylocoque étant
rappelons le, un germe habituel de la peau. En
cours d’hospitalisation, les cathéters de perfusion seront laissés
en place le moins longtemps possible afin de ne pas risquer
d’inflammation cutanée locale. Signalez
toute apparition de phénomène infectieux à votre équipe soignante ou
à votre médecin traitant après votre retour à domicile. La
survenue d’une infection avant l’opération est une
contre–indication formelle à la chirurgie. LE
SAIGNEMENT L’os
est une véritable éponge sanguine. Afin de positionner correctement la
prothèse il faut créer des coupes osseuses et décoller les muscles. Une
transfusion pourra être indiquée si les conditions hémodynamiques
l’exigent. Cette
transfusion sera autologue si on a effectué une autotransfusion en pré-opératoire,
ou grâce aux techniques d’épargne de sang. Toutefois
une transfusion conventionnelle sera nécessaire si le saignement est
trop important. LES
DOULEURS RESIDUELLES Elles ne sont pas rares. Les
douleurs peuvent se situer au niveau de plusieurs régions anatomiques
du genou. -
Douleurs latérales internes sur les zones de suture musculaires
et de l’aileron interne ; -
Douleurs péri rotuliennes souvent mal expliquées ; -
Douleurs en fin de flexion ; -
Douleurs au changement de temps plus banales ; -
Douleurs à type de tendinite. En cas de persistance anormale de phénomènes douloureux, il faudra prévoir une consultation chirurgicale et un bilan radiographique. LES
TROUBLES CICATRICIELS Plus
fréquents si le genou est multiopéré, porteur de nombreuses incisions
avant la prothèse de genou. Ils
peuvent justifier une reprise chirurgicale et rallonger la durée
d‘hospitalisation. La
sortie de la clinique ne s’effectue que si le genou est parfaitement
cicatrisé. ATTENTION Du fait de la section de petits nerfs cutanés, il existe une zone d ‘anesthésie ou dysesthésie (diminution de la sensibilité) des 2 cotés de la cicatrice. LA
RAIDEUR Un
genou opéré doit avoir des progrès de rééducation « linéaire »
dans le temps. La
flexion doit atteindre 90° en actif au bout de 15 jours. S’il
existe une raideur post-opératoire qui ne s’améliore pas après rééducation,
une mobilisation sous une courte anesthésie ou sous contrôle
arthroscopique pourra être proposée afin de ne pas compromette la
qualité du résultat final. LE
SUIVI CLINIQUE Une
prothèse de genou se surveille régulièrement avec des clichés
effectués à intervalles réguliers. Le
schéma de suivi habituel après la sortie de l’établissement de
soins est un cliché à 3 mois, puis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans,
5ans, 7 ans (période charnière importante), et 10 ans. Au
delà tout dépend de l’évolution de la prothèse. Si vous ne revenez pas aux consultations prévues ci-dessus ou en cas d’ une étude scientifique, il est possible que vous receviez une convocation afin d’ effectuer un examen clinique et radiographique. Il est dans votre intérêt de vous y rendre afin de participer à une meilleure prise en charge de votre prothèse. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||